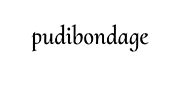L’anglais décrit dans le château fermé. – A.P. de Mandiargue – Chapitre X
in Art, L'anglais décrit..., Littérature
Chapitre X : Pendant la guerre
« Pendant la guerre, souvent, ils me livraient bien emballés et ficelés des officiers et des soldats qui étaient tombés dans leurs embuscades. Les prisonniers figuraient à mes spectacles, faisaient le sujet de mes expériences ; le maquis y gagnait d’être débarrassé d’eux sans se compromettre et de recevoir de moi quelque supplément de finance. Ainsi, d’un gros colonel wurtem-bergeois, je me rappelle que nous nous donnâmes la comédie de lui faire retirer son uniforme, son linge, et puis, tout nu, de tatouer sur la peau de son corps ledit uniforme sans en rien oublier, ni les jambières, ni les décorations, ni les galons, ni l’étui du pistolet, ni le moindre bouton réglementaire.
Après quoi, quand le bonhomme eût sucé (sans les mordre) les vits des nègres, et qu’il eût avalé tout le foutre, il fut expédié de la main de Caligula. J’ai grande sympathie pour les Israéliens, dont j’ai appris qu’ils faisaient subir la première partie de ce traitement à des officiers supérieurs et généraux de l’armée britannique, avant de les renvoyer, décorés de la sorte, à leur quartier. Ce serait une mode à répandre, que de tatouer ainsi tous les militaires de profession. Mon seul regret est de n’avoir jamais pu me procurer, malgré la promesse d’une grosse prime, un exemplaire de ces glorieux généraux russes qui, plus que tous les autres, sont chargés d’or et de quincaillerie ; sur tel cuir de cosaque, à graver ces grandes épaulettes, ces brochettes de médailles, pensez quel joli travail on aurait pu faire ! »
Un mugissement assez lugubre, derrière nous, mit fin au quasi-monologue de M. de Montorgueil C’était signal, me dit-on, qu’était servi le déjeuner — le nègre Gracchus qui beuglait et râlait dans un grand coquillage tourné en spirale. Nous descendîmes, quand le buccinateur eut définitivement perdu le souffle.
— N’est-ce pas chez vous une petite manie, demandai-je à mon hôte, de donner une telle importance à la race de tous ceux dont vous contez l’histoire ?
Votre observation est bonne, dit-il. Je ne suis jamais arrivé à perdre complètement cette vieille habitude anglaise, et mauvaise, de parler d’un beau caniche, d’un gros percheron, d’un persan crème, plutôt que d’un chien, d’un cheval ou d’un chat. Tout ce qui nous vient de ces foutues patries nous rend sots.
Et il me poussa vers la salle à manger.
Là, dans le décor de la veille (mais à cires éteintes ; les tentures, roulées comme des voiles au-dessus d’un grand vitrage, du côté de la cour, laissant entrer dans la pièce un jour plutôt maussade), je trouvai la compagnie à laquelle je m’attendais ; c’est-à-dire qu’il ne manquait que Michelette, qui avait fait son temps et dont les crabes devaient avoir déjà nettoyé les petits os. Nous prîmes place dans l’ordre de la soirée précédente, à cette unique différence, encore, que Montcul et Luna de Warmdreck ne partageaient avec personne leur canapé.
Edmonde, quoique surgie de la cuisine où, nous dit-elle, elle avait passé des heures à l’intention de notre gueule, était souriante et fraîche ; sa gorge et son cul bondissaient sous la chemise mauve, plus gros et plus beaux par l’effet d’une guêpière en cuir doré qui étranglait la taille. Les deux nègres firent leurs allées et venues avec de grands plateaux d’oursins, ce dont je me réjouis, d’abord, car je n’aime rien tant que les délicieuses grappes orange ou safran qui sont la ponte de ces vivants fruits de mer, mais je fus désappointé, car d’oursins ce n’étaient que des carapaces, et chacune contenait un testicule (d’agneau) braisé, sur un lit de purée d’échalotes. Blâmant ce mets, qui était, à mon goût, détestable, je lui trouvai pourtant de l’esprit, et j’en louai l’invention, car la coquille de l’oursin, couleur chair à l’intérieur et velue d’un poil piquant à l’extérieur, est morphologiquement un con avec tant d’évidence qu’elle pourrait passer pour une plaisanterie de la nature. Il y avait donc un certain humour à loger une couille en tel endroit, plus banalement adapté à recevoir une tête de vit.
Cependant que les nègres, avec des mines de porcs, dévoraient les testicules et gamahuchaient l’intérieur des carapaces, Montorgueil à son habitude, vitupérait l’Angleterre, et il nous contait des histoires d’un sien parent, Mountarse du siècle passé, avec qui la reine Victoria plantait ramures à son époux ainsi qu’à son amant principal : Lord Alfred Tennyson.
A la première bordée, dit-il, que mon oncle tira sur le royal matelas, il sodomisa Sa Gracieuse Majesté, et d’un si bel élan qu’elle en fut toute ravie, car elle avait fort à se plaindre du Poète Lauréat qui, pour des raisons fondées notamment sur la lecture de la Bible et du dictionnaire médical, ne la voulait emmancher pas plus d’une fois par semaine et jamais ailleurs que dans ce qu’il appelait le « vase de bonne moralité », id est : le vagin.

Mon oncle, au contraire, qui était un homme à queue, la besogna dans tous ses orifices, sans rechigner, après qu’il lui avait bien rempli le con, à lui en remettre plein le cul, plein la bouche et même plein les trous du nez. Il paraît — ce que je vous dis là, je l’ai lu dans les mémoires (encore inédits, malheureusement) de mon oncle Jonathan Mountarse — que la reine avalait goulûment le foutre et qu’elle raclait du plat de la main tout ce qui bavait et dégouttait de partout où on l’avait pinée pour se le jeter, après, dans le gosier, en braillant que c’était meilleur que du sabayon au whisky, et qu’auprès de la jute de Mountarse celle de Tennyson n’était que de l’eau de riz. Mon oncle finit par étriller la royale garce à coups de bretelles ; alors, pour l’en remercier, elle le fit chevalier de la Jarretière. Je n’ai pas réussi à la Cour aussi bien que sir Jonathan. Avouons, car en tout je veux être juste, qu’il bandait assurément plus vite que moi ; et puis les culs des royalties se sont rarement trouvés à portée de mon lastex.
Il s’interrompit pour se servir d’un plat de petites langues (si petites que je ne saurais les attribuer à nulles bêtes qu’à des cochons d’Inde), avant de reprendre, presque sans transition.
— Observez, je vous prie, l’objet par excellence usuel de la famille et du foyer en Grande-Bretagne : la théière anglaise. Il faudrait être bien dépourvu de sens critique pour admettre que pareil ustensile sert exclusivement à préparer des infusions. La forme, en vit mesquin, de son bec, son ventre rond que nos morues nationales emplissent d’eau chaude avant de se l’appliquer sur la motte, vous indiquent, sans possible erreur, sa destination.

La théière anglaise (certaine, que j’ai vue, était gainée d’astrakan comme le bas-ventre d’un zoulou) est un godemiché ; sans doute le restera-t-elle jusqu’à la fin du monde, ou jusqu’à ce que mes compatriotes aient appris (chose improbable) à faire reluire un peu leurs tristes femelles. N’est-ce pas, d’ailleurs, l’idéal de toutes les femmes au Royaume-Uni que l’homme-tronc, infirme à gros vit, théière encore, qui leur serait absolument remis à discrétion ? J’ajouterai, toujours à propos de cette forme singulièrement allusive, que la théière anglaise ressemble tellement aussi à la tête d’un rhinocéros que j’ai souvent rêvé de posséder un animal de cette espèce, dressé à foutre de la corne ; j’aurais lâché mon bestiau dans le Parc, à l’heure des petits sermons, et je vous assure qu’il y aurait eu du cri, du mouvement, de la joie…
Il devenait monotone, dans son chauvinisme à rebours (c’était comme un caquet de toupie irlandaise) ; alors, pour changer de musique, je lui rappelai qu’il m’avait promis une autre histoire, et précisément l’arrivée de son amie, la jeune princesse, à Gamehuche.
— Qu’en pense ladite jeune princesse ? demanda-t-il.
Et encore, maniant sans indulgence les seins de sa voisine :
— Répondras-tu, bougresse ? C’est de toi qu’il s’agit.
— La princesse et la bougresse sont aux ordres de M. de Montorgueil pour tout ce qu’il lui plaira d’exiger, dit l’Allemande, avec un soupir et un beau mouvement de gorge.
Bon, reprit-il ; je suis un galant homme, et sans le consentement de la principale intéressée je n’aurais rien raconté du tout, mais, puisqu’elle le veut, je commence.
« C’est donc entre le printemps et l’été de l’année 1942 que je rencontrai pour la première fois le général baron von Novar, lequel venait d’être promu au commandement des forces aériennes pour la région de basse Bretagne. Ayant entendu parler de votre hôte et serviteur comme d’une sorte d’original anglais (l’expression a toujours cours), dégoûté de sa propre patrie mais grand admirateur de la nouvelle Allemagne, le général m’avait voulu connaître, et fort civilement, je dois l’avouer, pour étonnant que cela paraisse), après que les siens m’eurent averti de la visite, il s’était fait conduire au château et présenter à moi. Au bruit de l’escorte motocycliste, pétaradant sur la plage en attendant que le gué devînt praticable aux machines, je m’étais heureusement avisé (pour éviter tout fâcheux incident) d’enfermer dans l’une des tours grillées deux Juifs que m’avait confiés le maquis et qui provenaient d’un petit village de l’intérieur, où ils s’étaient réfugiés assez légèrement.
« Novar, car j’avais su dire ce qu’il fallait pour plaire à telle brute, bientôt m’aima plus que tous ses compatriotes (qu’il méprisait, d’ailleurs, quand leurs grades étaient plus bas que le sien) ; ce fut au point qu’il ne pouvait plus se passer de moi, et trois ou quatre fois par semaine il venait me retrouver à Gamehuche. Son habitude était de se faire toujours accompagner par sa nièce, la jeune princesse de Warmdreck, que vous voyez là et que je touche au bon endroit, sous sa robe, en ce moment même. La princesse est maniable. La putain est rieuse. Rira bien qui rira le dernier. Mais je crois que je m’écarte de mon histoire.
Le général — pour revenir à notre mouton galonné — s’était donc pris pour moi d’une affection fanatique et, dans un accès de confiance qu’assurément je ne méritais pas, il me raconta, sous le sceau du secret, comment et pourquoi il avait emmené sa nièce avec lui. Le prétexte allégué étant qu’il avait besoin de la jeune fille en tant que secrétaire, la véritable raison de sa démarche avait été de lui faire quitter l’Allemagne pour qu’elle échappât au service du travail obligatoire et à certaines promiscuités indignes d’une personne de son rang, s’il y avait eu des princes régnants, avant Bismarck, dans la famille.
« Au début, c’est avec un petit ennui que j’avais subi des visites auxquelles l’équilibre fragile de ma position ne me permettait évidemment pas de me dérober, mais je fus séduit, bientôt, par le comique involontaire qui fait aigrette aux officiers supérieurs et généraux dans les armées de tous les pays du monde, et je ne me lassai plus des confidences de Novar. Un mouton, d’ailleurs, je le répète, pour le caractère. Et sa nièce commençait à me donner bien agréablement à penser. Avec eux venait souvent un troisième personnage, que je voyais avec moins de plaisir et qui me regardait sans amitié. Celui-là, dont il se laissait entendre, quoique de façon non pas officielle, qu’il était fiancé à la princesse Luneborge. servait avec le grade de pilote lieutenant dans les formations maritimes de la Luftwaffe ; son insigne était une chose en forme d’aileron ou de nageoire. Noble aussi, et de toute première catégorie, mais bien moins humain que bestial, c’était un garçon blanc et roux qui avait près de deux mètres de haut et qui répandait autour de lui une forte odeur de chenil. Peut-être abusait-il du shampooing au pyrèthic. S’il bandait avec ostentation (les culottes militaires et ces courtes vareuses sont coupées exprès pour faire montre de cela), il n’était pas besoin d’être devin, ni père aumônier, pour voir que la putain de nièce mouillait pour lui et que ia grosse bite du premier savait à fond les bons coins de ia seconde. Or (l’ai-je dit ?), j’avais ces coins-là dans la tète et dans le ventre comme on y a la poignante image de Saint-Pierre de Rome, des Invalides ou d’un bordel encore inédit.
La chaleur augmentant à mesure qu’allait la saison, le général envoyait quelquefois une voiture militaire pour me prendre à Gamehuche et me conduire sur une plage déserte, près de Saint-Quoi-de-Vit ; le trio s’y baignait habituellement sous la garde des seuls motocyclistes, postés, rigides, au pied d’une petite dune. Novar, qui s’abritait d’une ombrelle, jasait avec innocence, sans qu’il fût nécessaire de l’écouter plus que le gravier bruissant. Luneborge laissait que le soleil l’eût rougie, puis, toute pivoine et muette, elle se jetait à la mer et poussait très loin au large d’une nage puissante et tranquille. La suivait à courte distance ce bougre que je détestais : le lieutenant Conradin. J’étais bien sûr que les fiancés s’emmanchaient dans la pleine eau (succulent exploit, d’ailleurs, dont voici la recette éprouvée : la femelle faisant la planche, le mâle se place dessous, et puis, guidant le vit bandé dur à la fente de son choix, brutalement, si l’eau salée lubrifie mal, il enconne, ou encule, d’un bon coup de reins ; alors il n’y a plus qu’à se confier au mouvement des vagues, qui vous bercent l’échiné ainsi que des mains serviles appliquées sous un hamac ; mais n’oubliez pas, c’est prudent, de vous passer au cou, pour ne pas risquer de le perdre, caleçon ou maillot, le linge retiré au début de l’opération). Quand ils revenaient, après une heure ou plus encore, le visage tiré de fatigue et le souffle rompu, j’enviais l’homme. La putain s’abattait sur le sable, défaite comme si elle avait servi une escouade de tirailleurs ; paupières baissées tout de suite sur les patientes aiguës-marines que vous voyez là (je ne connais rien qui provoque aux grands excès comme le vide de telles prunelles enchâssées bleu pâle dans une peau bien dorée), elle séchait au soleil ses beaux cheveux, son beau pelage noisette exhibé sans pudeur aux aisselles. Lui, le salaud, d’une main glissée dessous je voyais qu’il lui maniait doucement les fesses, et il rebandait à l’ouvrage, tandis que d’une légère houle de la croupe et du ventre elle montrait qu’elle n’était pas insensible.
Foutrechaud ! je me jurai que la garce avant longtemps servirait d’étui à ma pine.
Mis au courant de mon désir, prévenus qu’il y aurait grassement à gagner le jour où l’on m’apporterait en bon état la triple proie, les hommes du maquis firent leur plan d’attaque. Ce fut le lendemain de la Saint-Jean qu’ils l’exécutèrent, et par une matinée de chaleur dense qui devait inévitablement faire courir au bain mon gibier, tandis que j’avais prétexté de sauts à travers le feu, de rondes et des autres fatigues de la veille pour ne pas m’écarter du château.
« Le soleil brûlait à faire péter les cailloux du rivage, et il tapait durement sur le ras des crânes germaniques. Aussi les motocyclistes qui, en bons soldats, dormaient debout à leur poste, furent-ils au sable avant d’avoir pu se mettre en garde, moins grièvement atteints qu’étourdis par des projectiles issus d’armes pneumatiques et silencieuses de mon arsenal particulier. Les trois personnages principaux venaient de se rhabiller si, même pour eux, il faisait vraiment trop chaud ce matin-là (et une demi-heure plus tard mes gens de main eussent trouvé la plage vide) ; nulle résistance n’étant possible, ils furent pris, ficelés, bâillonnés, encagoulés, jetés sur une charrette entre deux lits de varech comme des homards que l’on veut tenir frais. Alors on revint aux blessés (légèrement) et, puisque la mer commençait à monter, on les enfouit très proprement jusqu’aux épaules, tout nus, mais les bras liés au torse, dans le sable humide, à cinquante mètres à peu près des premières vagues ; cela de façon qu’ils eussent bien le temps de voir venir le flot avant d’être saisis dans ses remous. La noyade ainsi, par jappements, écume et dérobades, je suis assez d’avis que le système nerveux doit s’y déchirer, et s’effriter la raison, comme dans la mort sous le fouet. Peut-être même y avait-il trop de munificence à traiter aussi luxueusement un si piteux bétail que des plantons ordinaires de la Luftwaffe.
« Quant aux prisonniers, lorsqu’ils furent déchaperonnés (permettez-moi, s’il vous plaît, ce terme de fauconnerie!, ils se trouvaient dans la salle où nous sommes, et c’était vers la fin de l’après-midi ; rideaux tirés, toutes cires allumées, quoique au dehors il fît grand jour et que la chaleur fût encore excessive. Les maquisards étaient disparus, éparpillés dans la lande et dans le bocage sitôt après avoir empoché leurs napoléons.
Vous voyez autour de vous, à cette différence qu’il est maintenant dans son éclairage diurne, le théâtre du jeu ; passons brièvement en revue, acteurs, victimes, figurants, les personnes qui vont y prendre part :
Nous avons donc, du côté des étrangers, le général von Novar, le lieutenant Conradin et la princesse de Warmdreck. Les deux premiers sont en petit uniforme de la Waffe, mais chaussés d’espadrilles non pas réglementaires. Luneborge, pieds nus, est vêtue seulement d’une courte robe de plage en toile orange, qui fait belle montre de ses épaules brunes, de ses aisselles, de ses jambes et d’un intéressant début de gorge. « De l’autre côté, celui des habitants du château, voici d’abord le maître de maison, votre serviteur ; lequel porte ce jour-là une robe de chambre en cachemire noir, ceinturée de soie violette, qui lui donne un peu l’air de « Sa Grandeur Mgr de Garnehuche ». Entièrement nu sous cette robe de chambre, il est chaussé de pantoufles en daim noir, à talons violets. Se trouvent à sa droite et à sa gauche deux filles de race noire, nos jeunes amies Viola et Candida, toutes nues dans de longues robes fendues par devant et dégrafées qui, mauve l’une, la seconde rosé vif, ont été bâties de peaux de ces chèvres du Tibet qui ont le poil doux comme du cheveu de femme ; les jambes de ces coquines paraissent encore plus élancées du fait d’escarpins rouges à talons hauts. Les deux nègres Gracchus et Publicola, torse nu, pieds nus, n’ont rien que des culottes collantes — l’un satin blanc, cramoisi l’autre — qui leur tombent plus bas que le genou selon la mode des anciens pêcheurs napolitains ; et puis, pour compléter le costume ou pour occuper leurs mains, ils tiennent chacun sur un plat d’argent un grand bouquet d’asperges, dont Mgr de Gamehuche, comme avec distraction, sucera une branche, parfois.
« Seuls personnages que vous ne connaissiez pas {et pour cause !), deux Juifs dont il fut déjà question, John-Henry Rotschîss, trafiquant naguère en ferrailles, et le dentiste Simon Vert, achèvent la compagnie. Ces deux-là (je les y ai forcés sous prétexte de les protéger par tel déguisement) sont en habits de capucins, de la couleur brenneuse que vous savez ; leur teint livide, le brillant de leur peau suintant gras vont dans le froc aussi naturellement que des feuilles d’oseille sous le ventre d’une alose.
« Et maintenant, sans autre lever de rideau, le jeu commence. Les prisonniers se regardent, regardent autour d’eux, me regardent, avec quelque ébahissement et des cillements d’yeux qui font penser à des nocturnes saisis dans un faisceau de lumière. Puis les hommes ont dû se rappeler qu’ils sont sont de guerre, officiers, nobles et Prussiens, car ils prennent cet air de tronc que l’on sait et qui est une sorte d’érection morose. La fille, au contraire, toute molle, ondule comme une petite loutre apeurée.
« Selon les prérogatives de son grade, le général a droit aux premiers mots. C’est pour me dire que je serai fusillé, et qu’il va me montrer comment meurent les héros de son pays.
« — Double erreur, mon cher général, je ne serai pas fusillé car nul des tiens ne saura jamais que ce fut ici, dans un trou à crabes, le terme de ta trop longue carrière ; et il ne s’agit pas de mourir en héros de ton pays ou d’un autre, mais de me réjouir par le spectacle de ton abaissement, de ton déshonneur et des vexations que l’on va t’infliger. Hébreux, je vous livre le général, traitez-le comme il vous plaira.
« Je le mouche d’une double torsion nasale, je lui donne du pied aux couilles, je le pousse vers les Juifs. Ceux-là, voyant l’uniforme de leurs bourreaux habituels, d’abord avaient fui derrière la colonnade, puis, revenus à petit trot, ils s’étaient mis à ricaner si férocement et si horriblement que, n’eût été leur utilité en tant qu’instruments vexatoires, je crois que je les aurais fait dépêcher avant même de m’attaquer aux Allemands.
(à suivre)