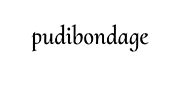L’anglais décrit dans le château fermé. – A.P. de Mandiargue – Chapitre IV
in Art, L'anglais décrit..., Littérature
Chapitre IV : Distribution des cartes
Le jour inclinait au sombre , et je me demandais si Viola, déjà, ne m’avait oublié, lorsque j’entendis le bruit de ses pieds sur les marches. Elle portait le vêtement et la chaussure que je lui avais vus, mais soigneusement rajusté celui-là, et elle avait un collier de grosses mouches en or qui remuaient au bas d’un ruban vert. Peignée flou, le visage délicatement touché d’une poudre pervenche, les lèvres un peu cyclamen, je la trouvai encore plus jolie qu’auparavant. Elle me dit que l’on dînerait dans une demi heure, et qu’elle allait descendre avec moi dans la salle de bains pour me regarder pendant que je me laverais, car elle aimait bien voir les hommes à leur toilette.
Remontés après divers ébats mais qui étaient restés dans l’ordre de la plaisanterie, quand je voulus ouvrir mes valises, elle ne me le permit pas, et elle tira pour moi, d’un autre compartiment du coffre-divan, une chemise à volants froncés, de la plus fine toile qui jamais eût effleuré ma peau, et encore un caleçon de soie, mordoré comme le ventre des buprestes. Là-dessus elle me fit passer une robe de chambre en cachemire blanc teinté de rose, avec de grands revers châle et une cordelière. Des bas noirs et des pantoufles à boucles d’argent complétèrent mon habit de soirée.
Après avoir traversé la cour ( comme il pleuvinait, Viola, pour abriter nos fringues, ouvrit un de ces parapluies familiaux démesurés qui servent aux portiers d’hôtel ), nous entrâmes dans le grand bâtiment ovale ; et là nous fûmes dans une salle à manger où je reconnus tout de suite sir Horatio ( pardon, M. De Montorgueil ! ) qui avait le même costume que moi, quoique d’une couleur beaucoup plus franchement saumonée.
Bonsoir, Montorgueil, dit la mulâtresse en me poussant devant elle. Voilà ton ami Balthazar. Il bande beaucoup plus vite que toi, et son sperme a un petit goût de violette qui m’a rappelé la salade d’éperlans.
A ce que je vois, dit mon hôte,,vous n’avez pas mal employé votre temps depuis que vous êtes arrivé. Ne vous excusez pas ; je n’attendais pas moins de vous. Et permettez que moi aussi je vous appelle Balthazar, puisque c’est le caprice de notre jolie petite Viola.
Tel surnom, qui m’avait procuré d’agréables moments, je ne le reniai pas. Alors M.de Montorgueil, rapproché de moi, poursuivit :
Je suis vraiment heureux que vous ayez accepté mon invitation. Il s’agissait , si ma mémoire est bonne, de venir me rejoindre dans un lieu que (plaisamment) je vous disais situé hors du monde, et d’y être mon compagnon à de certains jeux et à de certaines expériences. Gamehuche a toutes les qualités de ce lieu idéal. La nuit, la marée haute et les courants qui font tourbillonner la mer autour de nos remparts, ces grands murs et les portes verrouillées à marée basse, le désert de l’arrière-pays, la crainte encore qui s’attache aux environs d’un donjon mal famé, suffisent à retrancher absolument notre château de la commune terre des hommes et à la soustraire à leurs lois. Vous êtes le premier, en dehors de moi-même et de mes quatre noirs, qui soit venu ici de son plein gré depuis que j’y habite ; j’ajouterai tout de suite que vous et moi sommes les seuls à pouvoir en sortir quand il nous plaira, pourvu que ce soit heure de basse mer.
»Je vous ai invité parce que j’ai pu me rendre compte, une fois, que vous étiez un homme sérieux ; je suis également un homme sérieux à mon point de vue ; vous savez comme moi, que notre espèce ne pullule pas à la surface du globe. C’est en très grande partie la légèreté et la frivolité de tous ceux là-bas qui m’ont porté à me venir fixer ici, et à m’y enfermer. Je n’ai presque jamais pu bander, par exemple, hors de chez moi. Et vaut-il l’effort de bander quand on ne peut sérieusement pousser à bout la partie ? Je trouve que non, quant à moi ; d’autant plus que ma nature est singulière, et qu’elle exige pour me faire décharger et débander bien plus de substance et de peine que pour me mettre en l’air. Nous aurons ici le jeu qui convient à des personnages tels que vous et moi.
»Avant toute chose, je veux vous familiariser avec nos acolytes et avec nos serviteurs, les pions du jeu.
En dehors de vous – dorénavant : Balthazar – et de moi – nommez moi Montorgueil tout rond – le château ne contient que deux hommes. Vous avez déjà vu le nègre Gracchus, qui est valet quand il ne fait rien de mieux. Le nègre Publicola, qui est plus grand et beaucoup plus fort que lui, valet aussi me sert encore d’expéditif. Une délicate fonction, dont il s’acquitte à merveille ; vous verrez plus tard en quoi cela consiste.
»Les hommes, pour ce qu’en feront, je crois, Balthazar et Montorgueil, n’ont pas besoin d’avoir un âge. C’est tout au contraire avec les pions féminins.
»Votre amie, la jeune Viola, a dix-sept ans depuis douze jours. Cette fille très noire, à côté d’elle, qui vous regarde en riant ( je gagerai que l’autre lui a parlé de votre queue ), s’appelle Candida : elle a dix-neuf ans et un corps parmi les plus jolis que sachent les amateurs de négresses.
»Melle Edmonde, que voilà, déclare trente ans ; c’est ce que l’on est convenu d’appeler une jeune fille du monde, et, dans ce monde-là, son renom était de posséder le plus beau cul de Paris et de savoir s’en servir. Ici, nous l’avons mise à la cuisine, parce qu’elle s’entend bien à cela, non moins qu’à d’autres petites choses plaisantes, qui nous l’ont rendue presque indispensable.
»Vous verrez tout à l’heure Melle Lune-borge de Warmdreck, que par souci de notre confort vocal nous avons nommée, moins rudement, Luna ; fille d’un prince Hanovrien, elle n’a pas passée vingt ans que de trois ou quatre mois. La petite, en ce moment, qui entre est Melle Michelette, qui a treize ans et qui est vierge. »
Celle-ci me regardait avec un air de crainte. Quand elle vit que Montorgueil ne disait plus rien, elle fit pour lui et pour moi une révérence de cour, à l’Allemande, qui était bien la chose la plus touchante et la plus ridicule qui se pût faire étant donné sa mise. Car la petite fille était vêtue en putain de bordel. Ses pieds trébuchaient sur des souliers à talons hauts, ses mignonnes jambes étaient gainées de bas noirs, qu’au ras des fesses arrêtaient des jarretières fleuries d’un œillet de soie rouge. Sans peine on distinguait le détail de son corps gracile, formé de peu, sous le voile assez transparent d’une demi chemise-culotte en crêpe de Chine rehaussé de dentelle mousseuse. Autour du cou, elle avait un ruban rouge, cramoisi comme les fleurs de ses jarretières. Sa bouche était peinte grassement, ses yeux étaient agrandis de fard, ses cils collés par la brosse à rimmel, ses sourcils allongés au crayon, ses cheveux décolorés. Derrière elle apparut une grande créature châtaine, qui était probablement Luneborge de Warmdreck et qui, pour éloigner l’enfant de nous, lui cingla durement les mollets d’un fleuret très souple que sa main faisait siffler dans l’air. Il y eut quelques larmes, quelques gouttes de sang, et sur les bas une déchirure incarnée dans le vif qui donnait envie de mordre la nuque ou de serrer le cou.
Pourquoi faut-il que cette petite aille toujours se fourrer dans les jambes des autres ? Dit Montorgueil, approuvant le geste.
Parce que la chatte lui démange. Rien n’est malsain comme un pucelage. Il se fait là-dedans des croûtes et de la grattouille, du fromage, de l’ordure ; les bêtes y vont pondre et nicher ; le cresson y pousserait. On se demande si tu n’es pas fou, Montorgueil, de n’avoir pas encore mis cela en perce. Tu finiras par nous faire prendre la gale ou les écrouelles, avec tes vierges.
Luna s’exprimait avec véhémence, et sa superbe n’était pas mal servie par le jeu de son unique vêtement : une longue robe de chambre en peau de panthère (ou mieux, si laineuse et si pâle en était la fourrure des léopards des neiges), dépourvue de boutons ou d’agrafes et de haut en bas fendue, ce qui me permit de constater que la jeune princesse, particularité peu fréquente, même chez les filles nobles, avait le poil du con exactement de la même couleur entre noisette et feuille morte que ses cheveux ou ses sourcils. Jambes nues, ses pieds nus posaient sur des sandales dorées. Les ongles de ses pieds, comme ceux de ses mains, étaient vernis de nacre.
Soyons justes, dit-elle encore ; je reconnais que la petite putain a profité de mes leçons. Sa révérence était très bien. Feu mon oncle , qui était difficile, ne l’aurait pas désapprouvée. En récompense nous la laisserons manger tant qu’elle aura faim, ce soir, et même , avec le permission de Montorgueil, nous la laisserons boire.
Elle vexa l’enfant d’un soufflet dur au coin de la bouche. Nous nous assîmes en tumultes, les nègres maniant le cul d’Edmonde, cependant que notre hôte accordait pour Michelette la faveur demandée.
Nous étions dans une salle à manger toute ronde. Autour de nous, sous un plafond de bois doré, s’élevaient des colonnes de je ne sais quelle pierre, mais lisse, charnue, semblable à de la cire un peu rose – colonnes qui s’achevaient en de grosses boules près du plafond, lequel, pourtant ne posait pas dessus. L’éclairage n’était que de cierges et de bougies, d’une cire carminée comme la pierre des colonnes, issus de grands et de petits chandeliers tous au décor de filles broutées par des veaux ou foutues par des ânes. Le mur était recouvert d’une tenture flottante, en soie très lourde couleur de vin du Roussillon, que des courants d’air chaud, qui provenaient de bouches inférieures, faisaient onduler sans repos avec des reflets étranges. Entre ce mur et la colonnade il y avait une sorte de galerie circulaire où s’amoncelaient des peaux de bêtes, ours et tigres principalement, qui faisaient comme des sièges, comme des lits, comme des tribunes velues.

Le plancher, au centre , était nu, d’ébène ou d’un autre bois teint en noir et ciré ; des anneaux d’argent s’y trouvaient fixés, et y traînaient des objets surtout de ce métal, tabourets, bassins, calices, avec aussi des fouets, des sabres et des colliers pour dogues. Trois canapés entouraient la table ( un quatrième, pareil, était resté dans la galerie) : canapés courbes à trois places, montés sur un châssis en argent pourvu de petites roulettes, garnis de matelas et de coussins en satin topaze. Quant à la table elle-même, colossale et rocaille, elle était d’argent creux, et de l’eau chaude arrivait dedans par le pied pour la tiédir jusqu’à la température du corps humain. Point de nappe, point de serviettes. Une grande fouterie bien ciselée et de petits sujets obscènes amusaient le regard, entre les plats, les carafes, les assiettes et les couverts.
Si tu as besoin de t’essuyer la bouche me dit Viola, tu prendras mes cheveux ou ceux de Candida. Nous ferons pareil avec ton poil…
( à suivre )


 Personnage qui occupe une place tout à fait particulière dans la littérature Française. Imprégné de surréalisme, d’érotisme, d’art ,chantre patient à l’écriture précieuse, bègue, aristocrate, poète, Mandiargues (1909-1991) signe dans les années 50 : »L’anglais décrit dans le château fermé ».
Personnage qui occupe une place tout à fait particulière dans la littérature Française. Imprégné de surréalisme, d’érotisme, d’art ,chantre patient à l’écriture précieuse, bègue, aristocrate, poète, Mandiargues (1909-1991) signe dans les années 50 : »L’anglais décrit dans le château fermé ».